|  | |  | | "l'histoire du fantastique est inséparable de l'histoire des sciences, parce que c'est précisément dans les sciences que le fantastique trouve son fondement"
(MALRIEU Joël, Le fantastique, Paris, Hachette, coll. "Contours littéraires", 1992, p. 23)
|
| |  | |  |
|  | |  | | "Le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles face à un événement en apparence surnaturel"
(TODOROV T., Introduction à la littérature fantastique, Paris, Le Seuil, 1970, p. 29).
|
| |  | |  |
|
|  | |  | | Explications par Jany Boulanger, Cégep du Vieux Montréal. | 
Le XIXe siècle est aveuglé par le rêve d'un monde meilleur permis par les avancées spectaculaires de la science et de la technologie. [...].
Partout, en ces lendemains de la Révolution industrielle, on célèbre les victoires du Progrès par de nombreuses expositions universelles. Pourtant, une réalité sociale catastrophique sévit dans toute l'Europe : le prolétariat connaît des conditions inhumaines (les ouvriers sont maltraités et mal payés et leurs enfants, dès l'âge de douze ans, travaillent dans les mines et les usines); les conditions d'hygiène sont effroyables; les épidémies se multiplient… C'est pourquoi [...] homme en vient à se révolter non seulement contre le fantasme de pouvoir et de contrôle de la science, mais également contre l'idéologie même du Progrès en revendiquant le retour du rêve, du mystère, de l'imagination et même… de l'incertitude ! Aussi, des écrivains tels que Honoré de Balzac, Guy de Maupassant, Théophile Gauthier, Edgar Allan Poe et E.T.A Hoffman prêteront leur voix à tous ceux qui, comme eux, sont désenchantés par cette époque contradictoire. Ensemble, ils créeront le fantastique qui, mieux que tout autre genre littéraire, exprimera les peurs les plus profondes et les plus inavouables de l'homme d'hier et d'aujourd'hui.
On s'accorde pour dire que deux grandes intrigues hantent la plupart des récits fantastiques, soit celle du savant fou et de sa créature, soit celle du combat de l'homme contre le Mal. La première, qui répond au culte de la science du XIXe siècle, met en scène des chercheurs, aspirant à devenir Dieu, qui voient s'effondrer leurs illusions de toute-puissance devant leurs fuyantes créations (monstres, robots, androïdes… et aujourd'hui, clones!). L'histoire du roman Frankenstein ou le Prométhée moderne (1816) de Mary Shelley est sans doute un des exemples les plus connus de ce type de rêve devenu cauchemar. Par contre, la seconde, soit l'intrigue du combat de l'homme contre le Mal, représente l'affrontement de tout être avec une force écrasante qu'elle soit le diable, le double, la folie, l'étranger, la mort, etc. La littérature en foisonne d'exemples de ce genre; pensons au Dr Jekyll, personnage illustre de Robert-Louis Stevenson, qui se bat contre son double, Mr Hyde. ...
|
| |  | |  |
|  Catégories | 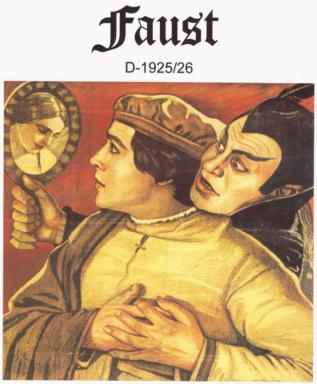 - Le pacte avec le démon : le modèle est Faust ; il en existe une multitude de variantes.
- L'âme en peine qui exige pour son repos qu'une certaine action soit accomplie : un défunt revient sur terre pour persécuter son meurtrier ; un châtiment attache un fantôme au lieu où il a accompli un forfait. L'Antiquité grecque connaît déjà ces différents types de revenants.
- Le spectre condamné à une course désordonnée et éternelle.
- La mort personnifiée, apparaissant au milieu des vivants. Tantôt lors d'une fête, sous l'éclat des lustres, elle désigne ses victimes l'une après l'autre, conformément aux instructions de l'inéluctable destin. Tantôt elle attend celui qui la fuit dans la retraite même où il avait couru se réfugier.
- La " chose " indéfinissable et invisible, mais qui pèse, qui est présente, qui tue ou qui nuit. La réussite inégalée de cette catégorie reste Le Horla de Maupassant.
- Les vampires, c'est-à-dire les morts qui s'assurent une perpétuelle jeunesse en suçant le sang des vivants : Hoffmann, A. Tolstoï, Balzac, Sheridan Le Fanu et bien d'autres ont fait de l'ancienne superstition étudiée par Don Calmet un des thèmes par excellence de la narration fantastique.
- La statue, le mannequin, l'armure, l'automate, qui soudain s'anime et acquiert une redoutable indépendance.
- La malédiction d'un sorcier, qui entraîne une maladie épouvantable et surnaturelle.
|
|  Les personnages du fantastique | - Fantômes : spectres, revenant, ombre, simulacre, apparition. Ils reviennent du monde des morts mais peuvent aussi être vivants (c'est alors leur reflet).
- Les Vampires (nosferats, stryge, lamie, goule, broucolaque) sont condamnés à errer parmi les vivants.
- Le double est intéressant puisque montre un état psychique possible.
- Automates, androïdes, mannequins sont forgés par les hommes.
- Les monstres sont des " choses " montrées ". Ils sont touchants de par leur solitude et qu'ils sont détestés (fonction de victime).
Pour exister, ces personnages ont besoin de sujets réalistes, d'où l'existence fréquente de scientifiques, qui sont par là même surpris.
|
|  Les actes |
Ils sont tous dans la transgression d'une règle, d'une limite. Il ne faut pas croire que seul le meurtre les appelle. La régression qu'ils entraînent n'est pas toujours volontaire mais peut l'être.
- L'apparition est l'acte de la surprise. Elle choque un personnage et demande une description dynamique minutieuse.
- La possession s'empare d'un sujet : sorciers et sorcières, magnétiseurs. Le diable s'en empare souvent mais pas toujours, certaines sociétés l'utilisant directement (vaudou). On utilise alors différentes techniques " paramédicales ". Le sorcier peut avoir l'allure d'un médecin.
- La destruction est moins utilisée et peut troubler le texte, l'entraîner dans la science fiction ou le genre " gore ". On reste difficilement dans le genre fantastique.
- La métamorphose est l'acte le plus courant et le plus typique du fantastique. Elle fait passer du réel à l'univers fantastique.
Le fantastique s'attache d'ailleurs davantage au résultat qu'à l'acte lui-même : déloger, défaire, déranger, dénaturer, etc… sont les actes les plus décrits. C'est alors l'art de l'illusion et … des désillusions.
|
|  Progression du récit fantastique | - UN MONDE REEL. Le texte fantastique construit d'abord un monde réel bien ordonné qu'il cherche ensuite à défaire. Il propose alors une régression des êtres et de ce monde vers des peurs et des émotions archaïques.
- DES AVERTISSEMENTS. Le récit fantastique, dans cette situation initiale, amène petit à petit des avertissements : des phénomènes, des comportements, inquiètent le lecteur.
- ARRIVEE DU FANTASTIQUE. Lorsque arrive le fantastique proprement dit, plusieurs activités sont alors possibles : apparition, possession, destruction, métamorphose.
- RECHERCHE D'EXPLICATION. Enfin, le texte propose ou suggère une explication du phénomène décrit, la plupart du temps aux dernières pages, afin de ne pas relâcher la tension créée par l'auteur. A la fin du 19ème siècle se sont développées les théories de la télékinésie et de l'hypnose. Les travaux sur les maladies mentales permettront également d'explorer ce qui était jusqu'alors compté comme de la folie.
|
|  Le fantastique au cinéma | 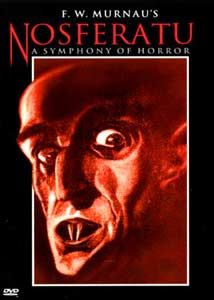 L'âge d'or du film fantastique américain (1931-1939) L'âge d'or du film fantastique américain (1931-1939)
De 1931 à 1939, aux États-Unis, c'est véritablement l'âge d'or du cinéma fantastique. On y assiste à l'avènement des grands mythes inspirés des classiques de la littérature de l'étrange et de l'effroi.
Dracula, réalisé par Tod Browning et présenté le 14 février 1931 aux États-Unis, est le premier film sonore d'épouvante. Adapté de l'œuvre de Bram Stoker qui avait inspiré Nosferatu, le Dracula de Browning avait pour opérateur Karl Freund, déjà responsable de la photographie de Metropolis (Fritz Lang), et trouvait en Bela Lugosi l'interprète idéal du comte Dracula, le maître des vampires, qui traversait, sans les déchirer, de gigantesques toiles d'araignées.
Frankenstein, mis en scène par James Whale, après le retentissement de Dracula, lui succède la même année. S'inspirant de l'œuvre de Mary Wollstonecraft Shelley Frankenstein, ou le Prométhée moderne (1818), Frankenstein donnait l'occasion à l'excellent maquilleur Jack Pierce de créer le masque pathétique porté par le monstre, incarné magistralement par un comédien jusqu'alors obscur, William Henry Pratt, plus connu sous le nom de Boris Karloff.
Alléchés par la vogue que connaissent Dracula et Frankenstein, les compagnies rivales de l'Universal mirent immédiatement en chantier tout un programme de films fantastiques, présentant un catalogue très complet de monstres, de médecins psychopathes et d'aliénés divers. En 1932, pour la Paramount, Rouben Mamoulian porte à l'écran le roman de R. L. Stevenson, Docteur Jekyll et M. Hyde, dont c'est la première - et sans doute la meilleure - version parlante, avec un étonnant Fredric March dans le double rôle de Jekyll-Hyde.
|
| 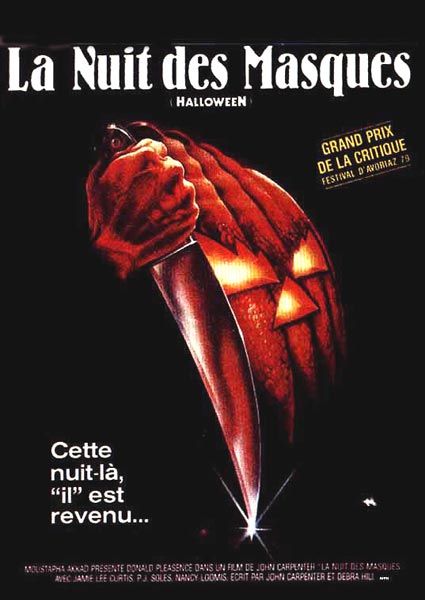 Le merveilleux français (1940-1945) Le merveilleux français (1940-1945)
De 1940 à 1945, le cinéma français s'efforce d'oublier la guerre à travers des ouvres d'évasion et voulues telles. C'est un cinéma qui s'ouvre naturellement au fantastique, ou plutôt à tous les fantastiques.
Un cinéma de la violence
Avec La Nuit des masques (Halloween, 1978), John Carpenter ouvrait, quant à lui, la voie à une kyrielle de tueurs, de fous criminels (psycho killers), descendants directs de Jack l'Éventreur, du pasteur assassin de La Nuit du chasseur de Charles Laughton (1955) ou bien du Norman Bates de Psycho, d'Alfred Hitchcock (1960). Obstinément attachés à leurs proie innocentes, ils sont les menaçants protagonistes de Maniac, Pulsions, Terreur sur la ligne, Le Bal de l'horreur, Le Monstre du train, et de tant d'autres, parmi lesquels se détache l'indestructible Jason, de la série des Vendredi 13. Entre cauchemar et réalité, Freddy Krueger, moderne croque-mitaine échappé des Griffes de la nuit (Wes Craven, 1984), persécute les adolescents tout au long de ses six films et d'une série télévisée... Dernier avatar du psycho killer : le fameux Hannibal le Cannibale qui hante Le Silence des agneaux (Jonathan Demme, 1990).
À force de surenchère et d'effets spéciaux de plus en plus élaborés, les films sanglants (gore pictures) ont atteint un réalisme stupéfiant dans le rendu des scènes à effets (décapitations, explosions et mutilations du corps humain).
Les années quatre-vingt-dix
Le fantastique traditionnel semble revenir en force, avec ses archétypes : les fantômes dans Ghost (Jerry Zucker, 1990) ; l'invisibilité dans Alice (Woody Allen, 1990) ; l'insolite dans La Famille Addams (Barry Sonnenfeld, 1991) ; le merveilleux dans Hook (Steven Spielberg, 1991) ; ou l'éternelle jeunesse, avec La mort vous va si bien (Robert Zemeckis, 1992).
Rien de nouveau sous les sunlights, donc. En 1992 - soixante ans après Tod Browning - Francis Ford Coppola adapte le roman de Bram Stoker. Son Dracula, œuvre romantique, tournée dans des décors gothiques et bénéficiant d'une technologie ultramoderne, est saluée par de nouvelles générations de spectateurs enthousiastes qui propulsent derechef les vampires aux premières places du box-office.
|
|
|

